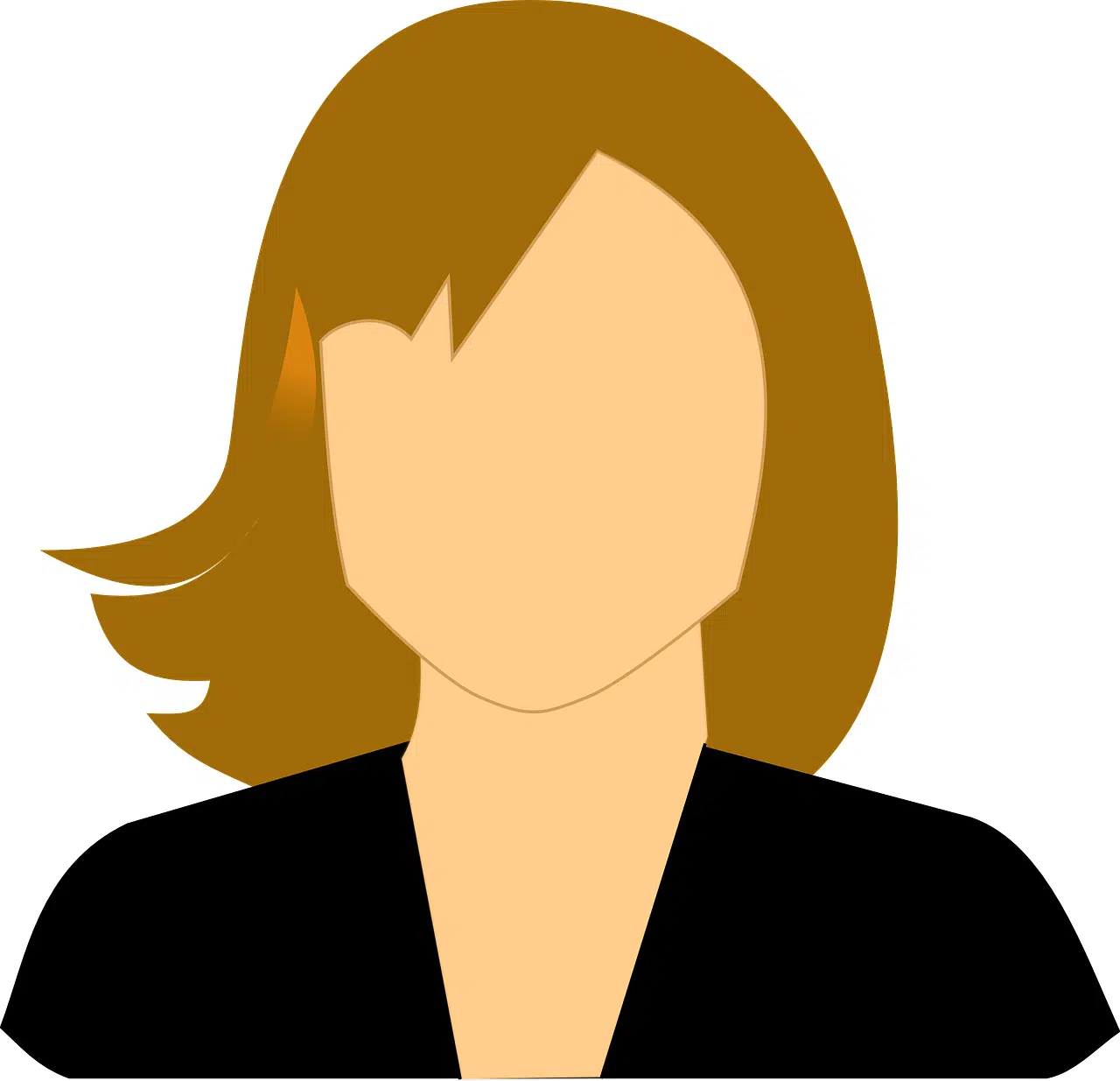Un chiffre brut : 130 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) interviennent aujourd’hui dans les établissements scolaires en France. Aucune obligation de diplôme, mais un recrutement qui trie sur le volet, des exigences qui s’aiguisent selon les académies, et un parcours semé de formations disparates. Derrière ce métier, une réalité : devenir AESH n’est pas une formalité, c’est un engagement, un choix de vie parfois, et une porte qui s’ouvre vers d’autres horizons professionnels.
Le contrat d’AESH ne promet ni stabilité absolue, ni ascension rapide. Pourtant, il peut marquer le début d’un vrai parcours professionnel dans l’éducation ou le secteur social. Même si la formation varie selon les académies, elle constitue souvent un tremplin pour s’insérer durablement et évoluer.
Le métier d’AESH : un rôle clé auprès des élèves en situation de handicap
L’AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) agit chaque jour auprès d’enfants ou d’adolescents qui ont besoin d’un soutien personnalisé pour suivre leur scolarité. Sa mission s’ancre dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS), en lien direct avec les enseignants et les familles. Sa priorité : rendre possible l’autonomie, favoriser l’inclusion scolaire et encourager la participation à la vie de la classe.
Voici ce que recouvrent les principales missions de l’accompagnant éducatif :
- Offrir une aide concrète au quotidien : installation en classe, déplacements, accompagnement lors des moments d’hygiène.
- Intervenir sur le plan pédagogique : soutenir pendant les activités, adapter le matériel, reformuler les consignes si besoin.
- Veiller à la socialisation : encourager l’élève à tisser des liens, à s’impliquer dans les temps collectifs.
Les situations de handicap sont multiples : troubles moteurs, difficultés cognitives, autisme, troubles sensoriels, troubles « dys »… Il faut donc savoir s’adapter, ajuster sa posture, parfois réinventer sa manière d’accompagner. Parfois, l’AESH suit un seul élève (AESH-i), parfois plusieurs (AESH-m), ou intervient auprès d’un groupe, comme en ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire). Dans certains établissements, le PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé) gère la répartition des accompagnants et optimise leur présence.
L’accompagnement s’inscrit dans la durée, en étroite coopération avec les enseignants, les professionnels du secteur médico-social et les familles. L’AESH participe aux réunions du PPS, partage ses observations, propose des ajustements. Bien souvent, il reste dans l’ombre, mais son action fait la différence, chaque jour, pour permettre la scolarisation effective des élèves concernés.
Qui peut devenir AESH ? Compétences, qualités et prérequis à connaître
Le métier d’AESH attire des personnes aux parcours variés. Pour candidater, deux options principales se présentent : posséder un baccalauréat ou avoir déjà travaillé au moins neuf mois dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap, que ce soit via un contrat aidé (PEC, CUI) ou dans une association. Certains diplômes du champ social, tels que le DEAES (diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social), le DEAVS, le DEAMP, ou encore le CAP AEPE (accompagnant éducatif petite enfance), servent aussi de passerelles reconnues.
Pour réussir dans ce métier, plusieurs qualités sont particulièrement recherchées :
- Faire preuve de patience et de ténacité dans des situations parfois difficiles.
- Savoir travailler main dans la main avec les enseignants et les professionnels du médico-social.
- Écouter, observer avec attention, préserver la confidentialité.
- Bâtir un climat de confiance avec l’élève et sa famille.
L’AESH doit sans cesse ajuster ses gestes, adapter sa façon de communiquer. L’empathie, la pédagogie et la disponibilité sont précieuses. Comprendre les besoins particuliers de chaque élève, accompagner sans dominer, soutenir sans infantiliser : c’est le cap à tenir. Toute expérience auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes en situation de handicap, même en dehors de l’école, compte lors du recrutement.
Quelles formations suivre pour exercer en tant qu’AESH ?
L’entrée dans le métier d’AESH s’appuie sur une formation initiale de 60 heures, imposée par le ministère de l’Éducation nationale, dès la prise de poste. Cette formation pose les bases : comprendre les différents types de handicap, s’initier à l’adaptation pédagogique, maîtriser le cadre juridique, connaître les acteurs de l’inclusion scolaire. On y aborde aussi bien les gestes professionnels que la posture à adopter avec les élèves, les familles et l’équipe enseignante.
Ce parcours se prolonge par un accompagnement continu, sous forme de modules thématiques répartis tout au long de la carrière. Ces temps de formation permettent d’affiner les pratiques, d’échanger sur des situations complexes, d’intégrer les évolutions du métier (PIAL, ULIS, projet personnalisé de scolarisation). Les AESH peuvent ainsi développer de nouvelles compétences : gestion des troubles du comportement, communication alternative, appui à l’autonomie…
Pour celles et ceux qui veulent s’ancrer durablement dans le secteur ou progresser, plusieurs diplômes reconnus sont accessibles : DEAES (diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social), CAP accompagnant éducatif petite enfance (CAP AEPE), DEAVS ou DEAMP. Certains de ces titres sont accessibles par la VAE (validation des acquis de l’expérience). Toutes ces formations contribuent à renforcer la professionnalisation du métier et à garantir un accompagnement de qualité pour chaque élève.
Évoluer et s’épanouir dans la carrière d’AESH : perspectives et développement personnel
Le métier d’AESH s’inscrit dans la durée, même si le chemin reste progressif. La plupart débutent par un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelable une fois, avant de pouvoir accéder à un CDI après six ans d’exercice. La rémunération, calée sur le SMIC lors de l’embauche, progresse avec l’ancienneté et l’obtention d’un contrat stable. Ce cadre, défini par l’Éducation nationale, offre des perspectives encore rares dans l’accompagnement scolaire.
Des possibilités de progression existent. Plusieurs AESH choisissent de se former à d’autres métiers du secteur social, comme le DEES (diplôme d’État d’éducateur spécialisé) ou le DEETS (diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé). La VAE (validation des acquis de l’expérience) permet aussi d’élargir son champ d’action auprès de publics fragiles. Souvent, l’entrée dans ces formations se fait en parallèle de l’activité professionnelle, avec le soutien des établissements et des organismes de formation.
Le quotidien d’un AESH n’est jamais figé. Chaque jour dans une école, un collège, un dispositif ULIS, amène à repenser sa façon de faire, à s’ajuster, à inventer parfois. Beaucoup évoquent la richesse des relations, la sensation d’être utile, la possibilité de faire bouger les lignes vers plus d’inclusion. Le métier permet d’acquérir des compétences précieuses : écoute, médiation, adaptation, travail en réseau. Des atouts solides, quel que soit le chemin choisi ensuite.
À la sortie d’une salle de classe ou d’une réunion d’équipe, l’AESH sait qu’il a contribué, un peu, beaucoup, à rendre l’école plus accessible. Ce n’est pas un métier qui se raconte, c’est un métier qui se vit, un pas après l’autre, au rythme de chaque élève.